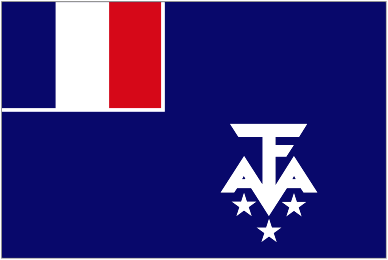Happy Sex de Zep.
Happy Sex de Zep.
Est-ce pour mieux décourager les bambins d'acheter le nouvel album de l'auteur de Titeuf que Zep a choisi un titre en anglais ? D'autant que dans le doute, et afin d'éviter tout psychodrame familial ou poursuite judiciaire, l'éditeur Delcourt a apposé en sus (si j'ose écrire) un autocollant "Réservé aux adultes" bien en évidence sur la couverture. Vous voilà prévenus, c'est le Journal du hard. Avec les gros plans et tout.
En même temps, on ne peut pas dire que Titeuf soit follement prude, ni que le Guide du zizi sexuel ait fait l'unanimité auprès de l'Office catholique des familles. Mais cette fois-ci, ça y est, Zep, qui travaille manifestement du gland, s'est lâché. Il s'est lâché, et puis pas vraiment non plus. C'est à dire que c'est du cul du cul du cul, et du très drôle, pour le contenu, avec ces gags en une planche où il excelle, dessinés avec un trait à la fois souple et précis, colorés avec le même goût exquis caractéristique de l'œuvre de Zep. Bref, Zep fait du Zep, mais mieux. Il fait ce qu'il sait faire. A la perfection. Comment le blâmer ?
Je sais qu'il est de bon ton chez certains dessinateurs rebelles et maudits de dauber sur le succès que rencontre Zep. Faut pas pousser, c'est quand même pas Uderzo. Enfin je me comprends. Personnellement je suis assez fan de tout ce qu'il fait, malgré des derniers Titeufs un peu en dessous. Et avec cet album tout à fait de son époque, décomplexé, mais rappelant curieusement d'autres galipettes dessinées comme celles de Lauzier, notamment par un sens de l'observation et une capacité à livrer une photographie des mœurs par le biais de l'humour, Zep retrouve la très grande verve qui animait ses Filles électriques ou L'enfer des concerts. Il croque des trognes pas possibles en les affublant de corps absolument tordants, si ce n'est parfois tordus. Chacun, garçon ou fille, se reconnaîtra aisément au gré des pages, dans certains épisodes parmi les moins honorables de sa vie sexuelle. Je me demande seulement si le propos en effet très adulte porté par son graphisme associé à l'enfance ne l'expose pas à décontenancer son lectorat habituel (d'où l'autocollant de mise en garde). En tout cas c'est suffisamment gaillard pour donner envie de tirer un bon coup sans coller les pages pour autant.
Je me demande seulement si le propos en effet très adulte porté par son graphisme associé à l'enfance ne l'expose pas à décontenancer son lectorat habituel (d'où l'autocollant de mise en garde). En tout cas c'est suffisamment gaillard pour donner envie de tirer un bon coup sans coller les pages pour autant.
Bon allez, ce livre a quand même un petit défaut : le mot "sex" a été découpé dans la couverture. Autant dire qu'on aura tôt fait de la, comment dire, niquer.
29 octobre 2009
Zizi sexuel
21 octobre 2009
L'enfant sauvage
 Fish Tank d'Andrea Arnold.
Fish Tank d'Andrea Arnold.
Rage ingrate à l'âge ingrat. Mia, quinze ans, vit avec sa mère qui la bat froid et sa petite sœur mal embouchée dans un grand ensemble d'une banlieue miséreuse de l'Essex. En conflit avec la terre entière, pensant s'émanciper par le hip hop (doux rêve car elle danse comme une brique), Mia finit par tomber sous le charme insidieux du nouveau petit ami de sa mère. Nouvelle illustration de la veine docu-réaliste sociale britannique, ce film repose presque entièrement sur le charisme de sa jeune actrice, Katie Jarvis, qui fit non sans raison sensation à Cannes. Pour le reste, on peut trouver beaucoup de plans superflus, au prétexte de descriptions naturalistes, beaucoup de scènes tirées en longueur, beaucoup trop de caméra-épaule sur les talons du personnage principal, épuisante dardennerie qui semble contaminer de plus en plus de cinéastes. Autant de petits travers qui contribuent à atténuer ce qui aurait pu être un grand coup de poing. Dommage, car le scénario plutôt habile, si ce n'était une métaphore chevaline un peu lourdingue, ménage quelques surprises. On y apprécie surtout une certaine neutralité de point de vue que la réalisatrice parvient à communiquer aux spectateurs, laissant une grande marge de manœuvre aux personnages eux-mêmes.
Nouvelle illustration de la veine docu-réaliste sociale britannique, ce film repose presque entièrement sur le charisme de sa jeune actrice, Katie Jarvis, qui fit non sans raison sensation à Cannes. Pour le reste, on peut trouver beaucoup de plans superflus, au prétexte de descriptions naturalistes, beaucoup de scènes tirées en longueur, beaucoup trop de caméra-épaule sur les talons du personnage principal, épuisante dardennerie qui semble contaminer de plus en plus de cinéastes. Autant de petits travers qui contribuent à atténuer ce qui aurait pu être un grand coup de poing. Dommage, car le scénario plutôt habile, si ce n'était une métaphore chevaline un peu lourdingue, ménage quelques surprises. On y apprécie surtout une certaine neutralité de point de vue que la réalisatrice parvient à communiquer aux spectateurs, laissant une grande marge de manœuvre aux personnages eux-mêmes.
Quant au titre Fish Tank, l'aquarium, mystère et boule de gomme. Peut-être Mia, comme un poisson rouge, ne pense-t-elle qu'à sauter hors du bocal où elle tourne en rond, au péril de sa vie.
Crash-test :
19 octobre 2009
Twist again à Moscou
 L'affaire Farewell de Christian Carion.
L'affaire Farewell de Christian Carion.
Imbroglio barbouzard. Au début des années 80, un colonel du KGB, par idéalisme et amour de la France, livre les secrets les plus précieux du renseignement soviétique à un insoupçonnable jeune ingénieur français en poste à Moscou, novice ignorant des us et coutumes de l'espionnage. Leur collaboration fructueuse va contribuer à l'effondrement du communisme. Tiré d'une histoire vraie, bien connue des milieux du renseignement, un peu moins du grand public, ce film de facture très classique met heureusement moins l'accent sur la mécanique de la combine d'espionnage et ses répercussions politiques, un peu embrouillées, que sur les deux principaux protagonistes, solidement campés par Guillaume Canet et Emir Kusturica (si quelqu'un peut porter un jugement sur l'accent russe du Serbe, merci d'écrire au journal). On se prend en effet de sympathie pour ces deux hommes très différents, mais qui malgré une méfiance réciproque, en viennent à s'estimer. Le double portrait est assez réussi, tout comme la reconstitution des années 80. Ce qui l'est moins, par contre, c'est justement les scènes représentant les dirigeants de l'époque, Mitterrrand, Gorbatchev, Reagan, où les dialogues deviennent assez lourdement explicatifs. La ressemblance des acteurs laisse beaucoup à désirer, et Fred Ward en Ronald Reagan scotché à longueur de journée devant des films de John Ford nous fait carrément bien rigoler. Je ne sais pas si c'était le but.
Tiré d'une histoire vraie, bien connue des milieux du renseignement, un peu moins du grand public, ce film de facture très classique met heureusement moins l'accent sur la mécanique de la combine d'espionnage et ses répercussions politiques, un peu embrouillées, que sur les deux principaux protagonistes, solidement campés par Guillaume Canet et Emir Kusturica (si quelqu'un peut porter un jugement sur l'accent russe du Serbe, merci d'écrire au journal). On se prend en effet de sympathie pour ces deux hommes très différents, mais qui malgré une méfiance réciproque, en viennent à s'estimer. Le double portrait est assez réussi, tout comme la reconstitution des années 80. Ce qui l'est moins, par contre, c'est justement les scènes représentant les dirigeants de l'époque, Mitterrrand, Gorbatchev, Reagan, où les dialogues deviennent assez lourdement explicatifs. La ressemblance des acteurs laisse beaucoup à désirer, et Fred Ward en Ronald Reagan scotché à longueur de journée devant des films de John Ford nous fait carrément bien rigoler. Je ne sais pas si c'était le but.
Pour finir, petite précision visant à expliciter le titre : les services français avaient choisi pour l'opération un nom de code anglais (farewell = adieu) afin de mieux tromper les services soviétiques. Et ça a marché. Interceptant finalement des communications occidentales mentionnant farewell, le KGB fut persuadé d'avoir affaire aux Américains, laissant encore du temps aux Français pour se retourner. Trop cons, ces Ruskofs.
Crash-test :
18 octobre 2009
Une femme disparaît
 A propos d'Elly d'Asghar Farhadi.
A propos d'Elly d'Asghar Farhadi.
Dynamite de groupe. Des jeunes gens de la bonne société téhéranaise se retrouvent avec femmes et enfants pour un week-end au bord de la Caspienne. La disparition subite et inexpliquée d'Elly, la jeune institutrice invitée à la dernière minute, va faire voler en éclat des relations d'amitié qui se croyaient inaltérables. Parvenu sur nos écrans peu de temps après la catastrophique élection présidentielle de juin, ce film iranien éveille naturellement la curiosité. C'est en vain pourtant qu'on y chercherait un sous-texte politique, ou alors passablement enfoui, même si bien entendu le contexte social iranien, et notamment les rapports entre les sexes, est essentiel au récit. Il s'agit en fait d'un portrait de groupe, d'une grande acuité et d'une grande cruauté, détaillant avec quelle promptitude, quand ils sont confrontés à une crise, les individus se dévoilent, se retournent les uns contre les autres, se défient, se manipulent, jusqu'à ne trouver d'échappatoire que dans une spirale de mensonges qui finit par ressembler à un cauchemar éveillé.
Parvenu sur nos écrans peu de temps après la catastrophique élection présidentielle de juin, ce film iranien éveille naturellement la curiosité. C'est en vain pourtant qu'on y chercherait un sous-texte politique, ou alors passablement enfoui, même si bien entendu le contexte social iranien, et notamment les rapports entre les sexes, est essentiel au récit. Il s'agit en fait d'un portrait de groupe, d'une grande acuité et d'une grande cruauté, détaillant avec quelle promptitude, quand ils sont confrontés à une crise, les individus se dévoilent, se retournent les uns contre les autres, se défient, se manipulent, jusqu'à ne trouver d'échappatoire que dans une spirale de mensonges qui finit par ressembler à un cauchemar éveillé.
Réalisée avec justesse sur un ton très réaliste, cette analyse psychologique percutante et émouvante parle en fait tout aussi bien à qui ne connaît rien à l'Iran contemporain ni n'a jamais trempé ses orteils dans la Caspienne.
Crash-test :
16 octobre 2009
La mauvaise vie
 La vida loca de Christian Poveda.
La vida loca de Christian Poveda.
Voir San Salvador et mourir. Dans une banlieue pourrie de la capitale salvadorienne, où seules prospèrent les entreprises de pompes funèbres, la vie trop brève d'un groupe de jeunes gens et jeunes filles membres d'une fraternité criminelle, la mara 18, au rythme des enterrements, des rafles de police, des règlements de compte.
C'est un peu comme un film d'horreur, sauf que tout est vrai dans ce pendant documentaire de la fiction italienne Gomorra. On hallucine à chaque scène, presque à chaque plan, des risques insensés qu'a pris le réalisateur pour tourner aussi près de ces gamins dont le plus âgés a vint-six ans (autant dire un ancêtre dans ce milieu très éphémère), mais aussi des forces de police, de l'appareil judiciaire, dans les prisons. Des risques tellement insensés que Poveda en est mort, abondamment fusillé peu après le tournage, sans qu'on sache très bien si ses assassins étaient des membres de la 18, d'un gang ennemi, ou quelque autre critique cinématographique à la gâchette susceptible. On aurait un peu mauvaise grâce, du coup, à aller chercher des poux à cette téméraire œuvre posthume. On préfère en louer la grande proximité avec ces personnages aux vies heurtées, rebuts sociaux sans espoir, qui trouvent un semblant de solidarité dans la nouvelle famille du gang, ou encore l'ironie qui juxtapose à chaque enterrement le rituel de la mara, prônant loyauté absolue et vengeance, et le sermon du pasteur évangéliste prêchant dans un désert surpeuplé d'assassins ses notions un peu exotiques de pardon et d'amour. Le pompon revient d'ailleurs a une scène d'une obscénité assumée : des évangélistes étasuniens prêchant la rédemption par le Christ à des détenus. Ce sont les mêmes WASPs blondinets, ici couverts de coups de soleil, intégristes fous de Dieu, qui soutenaient qui vous savez à Washington, dont la politique latino-américaine visait ni plus ni moins à maintenir le Salvador et toutes les nations au sud du Rio Grande dans un état de sujétion politique et économique propice à l'épanouissement des maras. Un peu comme si un barman vous narguait en vous exhortant à la tempérance tout en vous resservant votre dixième tequila.
On aurait un peu mauvaise grâce, du coup, à aller chercher des poux à cette téméraire œuvre posthume. On préfère en louer la grande proximité avec ces personnages aux vies heurtées, rebuts sociaux sans espoir, qui trouvent un semblant de solidarité dans la nouvelle famille du gang, ou encore l'ironie qui juxtapose à chaque enterrement le rituel de la mara, prônant loyauté absolue et vengeance, et le sermon du pasteur évangéliste prêchant dans un désert surpeuplé d'assassins ses notions un peu exotiques de pardon et d'amour. Le pompon revient d'ailleurs a une scène d'une obscénité assumée : des évangélistes étasuniens prêchant la rédemption par le Christ à des détenus. Ce sont les mêmes WASPs blondinets, ici couverts de coups de soleil, intégristes fous de Dieu, qui soutenaient qui vous savez à Washington, dont la politique latino-américaine visait ni plus ni moins à maintenir le Salvador et toutes les nations au sud du Rio Grande dans un état de sujétion politique et économique propice à l'épanouissement des maras. Un peu comme si un barman vous narguait en vous exhortant à la tempérance tout en vous resservant votre dixième tequila.
Si le film a la violence pour sujet, il réussit à en parler beaucoup en en montrant très peu. On imagine très bien d'ailleurs que le gang n'a accepté le tournage qu'à condition qu'un voile pudique soit jeté sur ses activités rémunératrices : trafics divers, enlèvements, extorsion. On ne devine d'ailleurs pas très bien si la petite boulangerie exploitée par les jeunes tatoués est un vrai projet de réinsertion ou une simple couverture pour embrouiller la police. D'autant que le responsable finit par être embarqué pour meurtre. Une spécialité locale, apparemment.
Crash-test :
15 octobre 2009
Allergie aux crustacés
 District 9 de Neill Blomkamp.
District 9 de Neill Blomkamp.
Série B prophétique. Un gigantesque vaisseau spatial extra-terrestre, victime d'une panne inexpliquée, stationne depuis vingt ans au-dessus de Johannesbourg. Ses occupants et leurs descendants, de répugnantes créatures aux faux airs de crevettes, sont parqués dans le district 9, bidonville sans foi ni loi, où ils se trouvent en butte à l'hostilité des autochtones, et exploités par des gangsters nigérians. En charge de cette population indésirable, une multinationale entreprend de la déplacer, espérant en profiter au passage pour percer à jour le secret des technologies militaires extra-terrestres. L'employé modèle qui pilote l'opération, raciste débonnaire, va être contraint par les événements à réviser sévèrement son point de vue sur la question alien. Le titre est une référence sans équivoque au district 6 de la ville du Cap, dernier quartier mixte d'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, qui fut brutalement évacué et rasé par le pouvoir dans les années 60. Ce film réalisé par un Sud-Africain émigré au Canada (pour la vue) a donc une résonance toute particulière pour ses compatriotes restés au pays. Mais en ayant digéré toute l'histoire récente de l'Afrique du Sud, post-apartheid y compris, Neill Blomkamp restitue une vigoureuse parabole de portée universelle sur le rapport à l'altérité, la tolérance, le pouvoir économique et la gouvernance médiatique. La leçon porte d'autant mieux qu'elle est donnée sous couvert des codes de la science-fiction et du film d'action dans un récit mené tambour battant. Les bonne idées succèdent aux trouvailles visuelles à un rythme soutenu, si bien qu'on ne sait vite plus s'il faut davantage admirer la virtuosité de la mise en scène ou l'intelligence du propos. Ce film se place ainsi d'emblée au niveau des chefs d'œuvre de Verhoeven, les prophétiques Robocop et Starship Troopers, dont il partage certains points communs.
Le titre est une référence sans équivoque au district 6 de la ville du Cap, dernier quartier mixte d'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, qui fut brutalement évacué et rasé par le pouvoir dans les années 60. Ce film réalisé par un Sud-Africain émigré au Canada (pour la vue) a donc une résonance toute particulière pour ses compatriotes restés au pays. Mais en ayant digéré toute l'histoire récente de l'Afrique du Sud, post-apartheid y compris, Neill Blomkamp restitue une vigoureuse parabole de portée universelle sur le rapport à l'altérité, la tolérance, le pouvoir économique et la gouvernance médiatique. La leçon porte d'autant mieux qu'elle est donnée sous couvert des codes de la science-fiction et du film d'action dans un récit mené tambour battant. Les bonne idées succèdent aux trouvailles visuelles à un rythme soutenu, si bien qu'on ne sait vite plus s'il faut davantage admirer la virtuosité de la mise en scène ou l'intelligence du propos. Ce film se place ainsi d'emblée au niveau des chefs d'œuvre de Verhoeven, les prophétiques Robocop et Starship Troopers, dont il partage certains points communs.
Peut-être Blomkamp en fait-il un chouïa trop dans un duel final où l'on reconnaît sans peine sa patte de spécialiste des effets spéciaux numériques (la pub des voitures-transformers, c'est lui). Et si le film manque d'un rien sa cinquième étoile au crash-test, ce n'est pas tant à cause de la musique ethno-new-age pas toujours très fine, que pour une chute trop ouverte semblant appeler un peu lourdement une suite. Les mauvais esprits y verront peut-être l'influence du producteur Peter Jackson, spécialistes des sagas. Gare à l'overdose de crevettes.
Crash-test :
A lire aussi : l'avis d'un cinéphile orléanais.
14 octobre 2009
Comme une lettre à la poste
 Mary et Max d'Adam Elliot.
Mary et Max d'Adam Elliot.
Miracle épistolaire animé. Mary, une gamine australienne de huit ans mal dans sa peau se choisit au hasard un ami de plume, ce sera Max, quarante-quatre ans, Juif new-yorkais obèse, solitaire et cliniquement dépressif. Deux personnalités aux antipodes l'une de l'autre, au propre comme au figuré, mais que rapproche toutefois un amour commun du chocolat, et le fort sentiment de leur inadéquation au monde qui les entoure. Sur ces bases improbables, malgré les hauts et les bas, leur correspondance va illuminer leurs deux vies. L'énoncé du sujet, rébarbatif au possible, suffirait à faire fuir bien des cinéphiles même férus d'animation. L'aperçu d'un design un peu bancal et grisâtre dans la bande-annonce n'encourageait pas non plus à l'optimisme le plus forcené. Il a donc fallu se faire un peu violence pour entrer dans cette salle, peu préparé au petit miracle qui allait se dérouler sur l'écran. Par la grâce d'une animation économe mais juste et précise, d'une mise en scène perpétuellement ingénieuse (je sais bien qu'on a pas affaire à des acteurs, mais alors il faut voir avec quel talent Adam Elliot dirige ses personnages, auxquels il faut ajouter un invraisemblable bestiaire, poulet rescapé de l'abattoir, chat borgne, poissons rouges suicidaires) et une utilisation érudite de toutes les ressources de la cinématographie, bande-son et musique compris, le récit nous captive avec presque rien, seulement l'échange des quelques mots que la fillette et le vieillissant adulte s'envoient par delà les océans, confrontation de deux monologues désolés constatant à l'unisson le désordre du monde et son infinie tristesse. Source de joie inépuisable pour les spectateurs emportés par des délices d'humour noir et profond, et par une très innocente crudité de langage à mettre entre toute les oreilles. Car si une fillette de huit ans a pu écrire et lire ces lettres, des petits spectateurs du même âge peuvent les entendre sans risquer l'otite.
L'énoncé du sujet, rébarbatif au possible, suffirait à faire fuir bien des cinéphiles même férus d'animation. L'aperçu d'un design un peu bancal et grisâtre dans la bande-annonce n'encourageait pas non plus à l'optimisme le plus forcené. Il a donc fallu se faire un peu violence pour entrer dans cette salle, peu préparé au petit miracle qui allait se dérouler sur l'écran. Par la grâce d'une animation économe mais juste et précise, d'une mise en scène perpétuellement ingénieuse (je sais bien qu'on a pas affaire à des acteurs, mais alors il faut voir avec quel talent Adam Elliot dirige ses personnages, auxquels il faut ajouter un invraisemblable bestiaire, poulet rescapé de l'abattoir, chat borgne, poissons rouges suicidaires) et une utilisation érudite de toutes les ressources de la cinématographie, bande-son et musique compris, le récit nous captive avec presque rien, seulement l'échange des quelques mots que la fillette et le vieillissant adulte s'envoient par delà les océans, confrontation de deux monologues désolés constatant à l'unisson le désordre du monde et son infinie tristesse. Source de joie inépuisable pour les spectateurs emportés par des délices d'humour noir et profond, et par une très innocente crudité de langage à mettre entre toute les oreilles. Car si une fillette de huit ans a pu écrire et lire ces lettres, des petits spectateurs du même âge peuvent les entendre sans risquer l'otite.
Ce film réanime l'animation avec culot, mariant une forme assez classique mais remarquablement maîtrisée avec un propos pessimiste baigné de drôlerie existentielle et de poésie un peu âpre. Ça change avec bonheur du gnangnan hollywoodien qui croit pouvoir dicter les lois du genre au reste de la planète.
Crash-test :
A lire aussi : l'avis d'un cinéphile orléanais.
11 octobre 2009
Plus c'est Long, plus c'est bon
 Passons, si vous le voulez bien, sur la qualité pitoyable du jeu de mots qui titre ce billet, et qu'on n'a sûrement, mais alors sûr de sûr, jamais fait à Guillaume Long. Ce jeune artiste dont le dessin est d'une simplicité presque profane, est l'auteur entre autres, de deux livres Comme un poisson dans l'huile et Les sardines sont cuites, indispensables à toute bibliothèque stéphanoise qui se respecte car narrant avec un humour glacial et sophistiqué les deux années que l'auteur a passées aux Beaux-Arts de Saint-Etienne. Deux livres pour lesquels j'ai eu droit à des dédicaces de la mort, tellement chiadées qu'elles en sont inscannables. J'aime aussi son Anatomie de l'éponge qui jette un œil amusé sur le petit monde de la BD.
Passons, si vous le voulez bien, sur la qualité pitoyable du jeu de mots qui titre ce billet, et qu'on n'a sûrement, mais alors sûr de sûr, jamais fait à Guillaume Long. Ce jeune artiste dont le dessin est d'une simplicité presque profane, est l'auteur entre autres, de deux livres Comme un poisson dans l'huile et Les sardines sont cuites, indispensables à toute bibliothèque stéphanoise qui se respecte car narrant avec un humour glacial et sophistiqué les deux années que l'auteur a passées aux Beaux-Arts de Saint-Etienne. Deux livres pour lesquels j'ai eu droit à des dédicaces de la mort, tellement chiadées qu'elles en sont inscannables. J'aime aussi son Anatomie de l'éponge qui jette un œil amusé sur le petit monde de la BD. J'en parle aujourd'hui, de Guillaume Long, parce qu'il est l'auteur d'un nouveau blog hébergé sur une plateforme gothique bien connue, versé dans la gastronomie au sens large si l'on en juge par le contenu des premiers billets consacrés au œufs et aux tomates, et aussi par le titre peu équivoque A boire et à manger. Long ne pense sans doute qu'à la bouffe, parce que son autre blog, davantage branché dessin, s'appelle tout de même, comme un interpellation de comptoir, Un café, un dessin . L'un dans l'autre, on profitera de ses cyber vitrines pour se familiariser avec un auteur à mon avis aussi discret qu'intéressant, autant d'invitations à découvrir son œuvre imprimée.
J'en parle aujourd'hui, de Guillaume Long, parce qu'il est l'auteur d'un nouveau blog hébergé sur une plateforme gothique bien connue, versé dans la gastronomie au sens large si l'on en juge par le contenu des premiers billets consacrés au œufs et aux tomates, et aussi par le titre peu équivoque A boire et à manger. Long ne pense sans doute qu'à la bouffe, parce que son autre blog, davantage branché dessin, s'appelle tout de même, comme un interpellation de comptoir, Un café, un dessin . L'un dans l'autre, on profitera de ses cyber vitrines pour se familiariser avec un auteur à mon avis aussi discret qu'intéressant, autant d'invitations à découvrir son œuvre imprimée.
10 octobre 2009
Ressources humaines
 Rien de personnel de Mathias Gokalp.
Rien de personnel de Mathias Gokalp.
Cinéma éparpillé façon puzzle. Une soirée de motivation pour cadres d'une société pharmaceutique se révèle être plutôt une évaluation générale en prévision d'un rachat de l'entreprise et des compressions de personnel qui en découleront. Bonjour l'ambiance. L'intérêt de ce premier film n'est absolument pas dans son sujet, somme toute assez banal, qui ne nous dit rien de bien nouveau sur le monde de l'entreprise et les relations humaines parfois cruelles en son sein, mais dans sa construction. Car la même histoire va nous être racontée trois fois de A à Z. Non pas en changeant de point de vue, mais en révélant petit à petit des éléments de dialogue ou des personnages qui manquaient à la version précédente, jusqu'à la version finale ou tout s'éclaire. Gokalp joue en fait avec son medium, l'image animée, en disséquant le langage cinématographique, pour nous montrer comment le sens des mots change selon qu'on entend la partie ou le tout, comment le sens des images change selon qu'on cadre large ou serré, etc...
L'intérêt de ce premier film n'est absolument pas dans son sujet, somme toute assez banal, qui ne nous dit rien de bien nouveau sur le monde de l'entreprise et les relations humaines parfois cruelles en son sein, mais dans sa construction. Car la même histoire va nous être racontée trois fois de A à Z. Non pas en changeant de point de vue, mais en révélant petit à petit des éléments de dialogue ou des personnages qui manquaient à la version précédente, jusqu'à la version finale ou tout s'éclaire. Gokalp joue en fait avec son medium, l'image animée, en disséquant le langage cinématographique, pour nous montrer comment le sens des mots change selon qu'on entend la partie ou le tout, comment le sens des images change selon qu'on cadre large ou serré, etc...
S'il faut bien admirer la maestria de l'exercice de style, il faut aussi regretter qu'elle n'ait pas été mise au service d'un sujet un peu plus intéressant, ce qui aurait pu donner un vrai grand film. D'autant plus qu'on y croise du beau linge : Denis Podalydès, Jean-Pierre Darroussin, Zabou Breitman, Bouli Lanners, entre autres. Du personnel très qualifié dont on ne se sépare qu'à regret.
Crash-test :
8 octobre 2009
Entre les murs
 Un prophète de Jacques Audiard.
Un prophète de Jacques Audiard.
Film d'application des peines. Un gamin vingtenaire entre en prison pour la première fois, et il va y gravir tous les échelons à la force du poignet, jusqu'à devenir le genre d'homme qu'on peut devenir en prison, c'est à dire quelqu'un de tout de même pas très recommandable.
Enthousiasmé par d'autres films d'Audiard, Un héros très discret, ou surtout De battre mon cœur s'est arrêté qui m'avait totalement transporté, je me suis laissé un peu monter le bourrichon par les critiques qui faisaient précéder ce nouveau film de la mention "attention, chef d'œuvre". Du coup mes attentes étaient-elles peut-être un peu excessives, et ma déception fut bien réelle malgré les immenses qualités de ce Prophète. Commençons par les qualités. Il s'agit d'un des meilleurs films jamais faits sur la prison, décrivant une réalité peu reluisante avec une précision quasi documentaire. Et le tableau qui en est dressé, loin de conforter le moindre romantisme criminel, fait assez franchement horreur, et devrait dégoûter tout candidat au séjour. Les petits rien de la vie quotidienne, la violence qui fait loi, la hiérarchie sociale, les groupes organisés, les trafics, la corruption, les visites... tous les spécialistes qui ont eu affaire au monde carcéral s'accordent à reconnaître la justesse de la reconstitution d'Audiard. Ensuite le propos, sur la construction dévoyée d'une identité par un gamin presque innocent parti de rien pour devenir caïd, est habilement porté par le récit, sans parler des interprètes, le jeune Tahar Rahim, et surout Niels Arestrup, qui en impose furieusement en parrain corse. Un propos dont la force oblige à réfléchir sur la nature de la prison, le sens d'une peine, et ses objectifs. Pour faire court, on voit dépeinte une académie du crime dont la société dans son ensemble pourrait peut-être se passer. Plus crûment, on doit se demander si l'abandon de fait dans lequel se trouvent les détenus, n'a pas in fine un coût social supérieur aux économies de bouts de chandelle qui sont faites sur leur dos au nom du contribuable. Et puis la mise en scène est assez brillante, avec des parti pris oniriques aussi casse-gueule que réussis, et une scène d'action au milieu du film où le temps semble s'emballer.
Commençons par les qualités. Il s'agit d'un des meilleurs films jamais faits sur la prison, décrivant une réalité peu reluisante avec une précision quasi documentaire. Et le tableau qui en est dressé, loin de conforter le moindre romantisme criminel, fait assez franchement horreur, et devrait dégoûter tout candidat au séjour. Les petits rien de la vie quotidienne, la violence qui fait loi, la hiérarchie sociale, les groupes organisés, les trafics, la corruption, les visites... tous les spécialistes qui ont eu affaire au monde carcéral s'accordent à reconnaître la justesse de la reconstitution d'Audiard. Ensuite le propos, sur la construction dévoyée d'une identité par un gamin presque innocent parti de rien pour devenir caïd, est habilement porté par le récit, sans parler des interprètes, le jeune Tahar Rahim, et surout Niels Arestrup, qui en impose furieusement en parrain corse. Un propos dont la force oblige à réfléchir sur la nature de la prison, le sens d'une peine, et ses objectifs. Pour faire court, on voit dépeinte une académie du crime dont la société dans son ensemble pourrait peut-être se passer. Plus crûment, on doit se demander si l'abandon de fait dans lequel se trouvent les détenus, n'a pas in fine un coût social supérieur aux économies de bouts de chandelle qui sont faites sur leur dos au nom du contribuable. Et puis la mise en scène est assez brillante, avec des parti pris oniriques aussi casse-gueule que réussis, et une scène d'action au milieu du film où le temps semble s'emballer.
Malheureusement, tout ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Un écueil qu'a rencontré Audiard c'est qu'en voulant, nécessairement, faire sentir l'écoulement du temps derrière les barreaux, il a dû étirer un peu la durée du film, de façon si palpable qu'on doit bien regarder sa montre plusieurs fois au cours de la projection. C'est un peu trop long, même si on comprend ça comme une obligation. La musique un peu lourdingue par moments vient renforcer encore ce sentiment. Et surtout, alors qu'on est pris par l'histoire, proche des personnages, presqu'incarcéré soi-même, voilà-t-y pas qu'on nous rajoute de grosses incrustations sur l'écran, avec le nom d'un personnage, ou d'un lieu, ou d'une période de l'année, affiché en gros caractères. Comme si un écrivain nous livrait son dernier roman avec les passages les plus importants passés au surligneur fluo pour les mal-comprenants. Effet de distanciation désastreux, qui nous rappelle soudain qu'on est assis bien au chaud dans un fauteuil de cinéma, et plus entre les quatre murs lépreux de Fleury-Mérogis.
Enfin le film déjà long, compte une scène de trop, celle de la sortie de prison, qui n'ajoute strictement rien vu que tout a déjà été dit, mais qui frise le happy end hollywoodien le plus sirupeux que c'en est presque ridicule, exigence de producteur peut-être, mais qui nous laisse sur une impression négative. Depuis le début du film on se doutait un peu de comment ça allait finir, pas besoin d'enfoncer les portes de prison ouvertes.
Crash-test :
7 octobre 2009
La rubrique vexillologique
 Je signalai il y peu à notre bon ami Appollo, qui passait récemment encore ses grandes vacances chez les tortues, un bien intéressant article d'une gazette gothique concurrente sur les îles Eparses de l'Océan indien. Un article un peu abusivement intitulé Un drapeau pour les Eparses, qui a l'intéressante particularité de n'offrir aucune information quant au moindre drapeau pour la moindre île, mais entend de façon figurée le mot drapeau comme synonyme de souveraineté.
Je signalai il y peu à notre bon ami Appollo, qui passait récemment encore ses grandes vacances chez les tortues, un bien intéressant article d'une gazette gothique concurrente sur les îles Eparses de l'Océan indien. Un article un peu abusivement intitulé Un drapeau pour les Eparses, qui a l'intéressante particularité de n'offrir aucune information quant au moindre drapeau pour la moindre île, mais entend de façon figurée le mot drapeau comme synonyme de souveraineté.
Le même Appollo, celui-là même qui, ayant échoué, malgré de méritoires efforts, à se faire trouer la peau en Angola, est allé tenter sa chance sous des cieux plus favorables à la fusillade généralisée, me signale que les îles Eparses sont néanmoins dotées d'un drapeau (celui des TAAF, Terres australes et antarctiques françaises) que le monde entier ne nous envie pas car inélégamment conçu par quelque obscur maréchal des logis un lendemain de cuite avant la corvée de guano, que doivent cependant hisser puis saluer des cohortes de tortues chaque 14 juillet, et que voici :
Moi je dis : ça manque de tortues.
5 octobre 2009
Je sais rien, mais je dirai tout
 The Informant de Steven Soderbergh.
The Informant de Steven Soderbergh.
Vingt-quatre mensonges par secondes. Un ingénieur bio-chimiste, cadre sup chez un producteur industriel de dérivés du maïs, accepte de collaborer avec le FBI pour exposer des ententes illicites et un cartel de fait auxquels prend part son employeur. Le problème, c'est que cet informateur de première bourre se double d'un mythomane de même catégorie, également escroc à ses heures, qui finit par mettre en danger tous ceux qui ont affaire à lui. L'action se passe pour l'essentiel aux Etats-Unis au début des années 90, pour s'achever en 2006, mais curieusement Soderbergh a choisi dès le générique début une esthétique nettement rétro évoquant plutôt les années 70 ou 80. Peut-être s'agit-il, comme pour la Cogip des fameux Messages à caractère informatif de Canal +, de railler le ringardisme du monde de l'entreprise. Mais, en ajoutant à ça une petite musique gentiment moqueuse également datée, on a un peu de mal à prendre au sérieux le cœur du scénario et son faux jeu de révélations dont la géométrie varie au gré des mensonges de l'informateur. On ne prend pas non plus très au sérieux le personnage principal, insaisissable anguille pourtant honnêtement interprétée par Matt Damon. On ne prend pas plus au sérieux des seconds couteaux issus de séries TV émoussées.
L'action se passe pour l'essentiel aux Etats-Unis au début des années 90, pour s'achever en 2006, mais curieusement Soderbergh a choisi dès le générique début une esthétique nettement rétro évoquant plutôt les années 70 ou 80. Peut-être s'agit-il, comme pour la Cogip des fameux Messages à caractère informatif de Canal +, de railler le ringardisme du monde de l'entreprise. Mais, en ajoutant à ça une petite musique gentiment moqueuse également datée, on a un peu de mal à prendre au sérieux le cœur du scénario et son faux jeu de révélations dont la géométrie varie au gré des mensonges de l'informateur. On ne prend pas non plus très au sérieux le personnage principal, insaisissable anguille pourtant honnêtement interprétée par Matt Damon. On ne prend pas plus au sérieux des seconds couteaux issus de séries TV émoussées.
On aboutit ainsi à une tragi-comédie ni très comique ni bien tragique, dont le propos assez confus semble nous échapper au moins autant que la personnalité du personnage principal, menteur compulsif, échappe aux agents du FBI. On ne peut pas dire que ce soit follement informatif.
Crash-test :